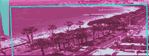|
|
|
 | |
LA GANG DE SCORSESE
 Pardon pour ce titre aux accents québécois, mais après tout mon passeport authentifie cet emploi du joual. Je ne peux pas résister longtemps : j'ai vu les fameuses 20 minutes (rien à voir avec un journal gratuit distribué à Paris) du dernier Scorsese. Noyé au milieu des hommages (Piccoli en Tati, Claude Rich et Resnais, le "généreux" Billy Wilder à "l'humour irrévérencieux", Cannes 1939...), l'événement de ce week end au climat incertain fut évidemment Gangs of New York. La pluie du samedi laissa place à un lundi de Pentecôte caniculaire et surpeuplé. Tous voulaient voir Léonardo (qui ne montra pas une seule fausse dent aux photographes). Cameron Diaz fut plus généreuse, mais bien moins applaudie. C'est difficile d'être une star aussi. Pardon pour ce titre aux accents québécois, mais après tout mon passeport authentifie cet emploi du joual. Je ne peux pas résister longtemps : j'ai vu les fameuses 20 minutes (rien à voir avec un journal gratuit distribué à Paris) du dernier Scorsese. Noyé au milieu des hommages (Piccoli en Tati, Claude Rich et Resnais, le "généreux" Billy Wilder à "l'humour irrévérencieux", Cannes 1939...), l'événement de ce week end au climat incertain fut évidemment Gangs of New York. La pluie du samedi laissa place à un lundi de Pentecôte caniculaire et surpeuplé. Tous voulaient voir Léonardo (qui ne montra pas une seule fausse dent aux photographes). Cameron Diaz fut plus généreuse, mais bien moins applaudie. C'est difficile d'être une star aussi.
Vous observez tout ce manège coloré dans la grande salle, en regardant votre téléphone (quand on n'a pas de montre). Sharon fait son show. Les commentaires sont bon enfant et les journalistes sérieux se muent en pipelettes de potins. La montée des marches a duré un quart d'heure, la standing ovation cinq minutes, le photo call dix minutes, la conférence de presse une heure. Faisons le calcul : une heure et demi autour de 20 minutes d'un film qui sort fin 2002! Cherchez l'erreur.
Mais il a fallu attendre. On ne livre pas en pâture aux médias en surtension un tel scoop sans leur aiguiser l'appétit. Ce fut l'hommage à Billy Wilder. Scorsese avait pris un peu plus de retard sur son montage final (rappelons que Gangs of NY devait sortir fin 2001 avant d'être mis en option pour ce 55ème Cannes) en revoyant tous les films de ce pygmalion malgré lui. Le premier film que Marty avait admiré au cinéma fut Sunset Boulevard en 1950, "un film d'horreur sur Hollywood (bien plus cynique et cruel qu'Hollywood Ending). Une dizaine d'extraits plus tard (de Sabrina à Some like it hot), après cet apéritif remaché en DVD par les fans (j'en suis), la Palme d'Or (Taxi Driver) et actuel Président du jury des courts métrages, nous offre notre cadeau.
Les 2000 personnes privilégiées, ce gratin cannois où l'on mélange les patates et la crème de la crème, écarquillent les pupilles et se laissent inonder d'images. Ce film qu'il porte depuis l'âge de 10 ans sur le vieux New York et ce livre qu'il a lu en une journée le 1er janvier 70 s'offrent à nous par de longs extraits qui dévoilent l'Histoire, les scènes marquantes, et décrivent les personnages. Ce que nous voyons est une immense promesse : celle d'un film majeur, artistiquement, cinématographiquement. Les visages défilent dans ce drame sanglant porté par la vengeance, les gangs et les ghettos, la chair et les cicatrices, les armes blanches tranchantes et les coups tordus. Les nerfs sont à vif. Décors, costumes, acteurs, effets visuels, tout semble chercher la perfection.
A Five points se définira l'Amérique et ce que sont les Américains. C'est ce qu'affirme Scorsese, sorte de Napoléon rital, en lançant la bobine.
Nous voilà désormais sur notre faim. Il faudra attendre. Se gaver d'autres films. Scorsese était venu en "gang" à Cannes, en chef incontesté. Même si le Parrain (Harvey Weinstein) imposait sa silhouette massive. Lequel aura le dernier mot sur le montage?
PS : L'histoire se passe entre 1846 et 1863, au moment des premières vagues massives d'immigration (principalement irlandaise). Les "natifs" refusent ces étrangers qui ne se sont pas battus pour l'Amérique, de leur mains ou de leur sang.
Lors d'un combat entre un prêtre et un boucher, deux gangs s'affrontent. Et le boucher règnera longtemps, avec la complicité des pouvoirs publics, sur Five Points. Mais le fils du prêtre revient 15 ans plus tard et jure de venger son père. Lentement il gagne la confiance de Bill le boucher et devient son bras droit. Pour son malheur son meilleur ami trahira ses intentions réelles et il sortira avec la copine du chef.
Une nouvelle guerre des gangs se préparent...
|  |  |
|
 |
 |
| Photos matons
Un couple de pies se pose dans les arbres cernant le balcon de l’appart transformé en QG d’Ecran Noir l’espace d’une dizaine de jours. Les deux volatiles en habit d’apparat noir et blanc s’emploient à se libérer rapidement un périmètre V.I.P. dans les étages de branches feuillues, délogeant les paisibles tourterelles grises d’un concert de cris autoritaires. Reproduction naturelle de l’écosystème cannois.
Le spectacle fait surgir brutalement dans mon esprit encore embrumé le souvenir d’un week-end férié agité qui a laissé l’équipe sur les rotules. Tel Spider, le personnage central et totalement à l’ouest du nouveau Cronenberg, je me suis réveillé totalement décalqué, installant avec mon compagnon d’écriture de la colonne de gauche, un dialogue composé de grognements inintelligibles. En commençant à noter sur mon carnet mes habituels hiéroglyphes indéchiffrables, la mémoire me revint peu à peu sur les événements passsés.
Hier, donc, la haute affluence festivalière atteignit son paroxysme sur l’échelle de Jacob. Les organisateurs avaient réservé un morceau de choix aux plaisanciers, puisque l’équipe de Gang of new York déboulait sur la croisette. Si une bonne partie du générique avait fait le déplacement, un seul nom revenait en leitmotiv : Leonard Di Caprio. Je devrais dire plutôt Di Carpaccio, puisque c’est le sobriquet qui lui est désormais attribué par la foule de fans présents pour l’accueillir. Car on estime que l’adoration qui est accordée au jeune acteur américain ne porte pas sur son évident talent, mais immanquablement sur son aura médiatique persistante, bien que le Titanic ait touché le fond depuis belle lurette.
Planté dans la foule au niveau des marches, j’ai écouté les gens en auto compression se plaindre. Apercevoir la star n’est certes pas très gratifiant, un homme revendique que ses impôts locaux devraient lui permettre de s’attribuer une place privilégiée, une vision des choses qui en vaut une autre… Asphyxié, je lève le camp et décide d’accompagner les photographes qui ont accompli leur tâche sur le tapis rouge. Engoncés et suant dans leur smoking, ils rejoignent au pas de course le haut du bunker en trainant tant bien que mal leur matos encombrant. Direction le photocall officiel. Obsédés par la nécessité de livrer le cliché qui répond à l’attente des secrétaires de rédaction, les parias du téléobjectif sont les âmes en peine peu respectables du festival. On voit traîner les plus connus devant les terrasses des cafés, l’œil aux aguets pour allumer la moindre célébrités monnayable.
Di Caprio est passé en coup de vent au point stratégique où je m’étais posté. Intérêt zéro. Mais qu’attendait de la vedette le public exaspéré ? Une révélation fracassante sur sa collaboration avec l’italo américain Scorsese ? Non, juste contempler l’acteur de ses propres yeux, réévaluer à la baisse son irréalité, pour monter à la hausse son propre ordinaire. Ca donne : « J’ai croisé Di Caprio, je le pensais plus grand…plus blond … moins bronzé…quand je vais dire ça à mes copines, elles vont être folles » Une façon de se valoriser tout en ristuant la star dans le commun des mortels.
Ensuite les flash protocolaires des paparazzis crépiteront sur le toit du palais. Réinstallant cette distance qui fascine et frustrent en même temps ceux qui doivent se résoudre à n’être que spectateurs passifs devant les médias.
|
|
 |
|  |