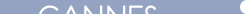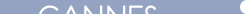|
Choix du public : 
Nombre de votes : 12
 

 

 

 

 

 

|

|
 |
 |

Parasite

Sélection officielle - Compétition
/ sortie le 05.06.2019


THE HOSTS
« Vous êtes payés, aujourd’hui. Considérez que ça fait partie de votre travail. »
Dès le départ, la famille d’arnaqueurs de Parasite nous en rappelle une autre, celle d’Une affaire de famille, Palme d’or méritée à Cannes en 2018. De la même manière que Kore-Eda, Bong Joon-ho utilise en effet la cellule familiale pour parler des difficultés sociales de son pays, mais aussi de l’entraide et de la solidarité qui peuvent y régner. Ses personnages ont beau être des figures de perdants qui habitent dans un entresol et vivent d’expédients, le film ne les condamne pas d’avance, et les montre au contraire soudés et heureux, notamment dans les scènes d’exposition qui jouent presque la carte de la comédie.
C’est pourtant dans un registre plus sombre, et plus cruel, que bascule peu à peu le film. Les personnages, qui sont incontestablement des battants, savent saisir l’opportunité que leur offre la vie, et n’hésitent pas à forcer leur chance. La première partie, qui conte leur ascension sociale, est d’ailleurs brillante et irrésistible, à la fois dans son écriture et dans sa mise en scène qui renforce l’ironie implicite des situations. Il faut voir « Jessica » jouer les artistes autoritaires après avoir lu quelques articles sur internet, ou « Kevin » simuler la sévérité face à sa petite élève. Les stratégies mises au point par la famille pour évincer les domestiques et prendre leur place sont de la même manière de grands moments d’humour noir.
Mais évidemment, Bong Joon-ho n’allait pas s’arrêter là dans sa démonstration virtuose des limites de la prospérité sud-coréenne. Il ménage ainsi plusieurs niveaux de rebondissements qui viennent contrebalancer l’aspect sympathique des petites entourloupes du début. Car les Ki-taek s’aperçoivent qu’ils ne sont pas les seuls à souhaiter vivre aux crochets de la famille Park. Confrontés à leurs doubles, ils prennent alors conscience de la fragilité de leur condition. Et de ce qu’ils sont prêts à faire pour la conserver.
Le réalisateur, formidable observateur social, décrit ainsi avec une précision clinique deux mouvements distincts : d’une part la rencontre entre deux mondes qui évoluent dans des dimensions parallèles (l’appartement minables des uns, la vaste demeure des autres ; les préoccupations absurdes des uns, les problèmes matériels bien concrets des autres), et de l’autre la rencontre entre deux univers qui sont trop semblables pour pouvoir cohabiter. Le choc des cultures n’est pourtant pas immédiat. Au contraire, Bong joon-ho prend le temps d’installer ses situations, puis de les dégrader cran par cran, jusqu’à l’inévitable explosion finale. Celle-ci, une fois n’est pas coutume, se fait en plusieurs temps. Purement défensive, puis offensive, et pour terminer vengeresse. Trois étapes dans la lutte des classes version Bong Joon-ho, pour qui le comble de la violence est que les pauvres en soient amenés à s’entretuer pour les miettes du gâteau des riches, au lieu de faire preuve d’un minimum de compassion, à défaut de solidarité de classe.
Mais évidemment le fossé finit par se creuser également entre les personnages les plus modestes et la riche famille qui l’emploie. Bong Joon-ho prend bien garde à éviter la caricature, et à ne surtout par forcer le trait. Les employeurs sont donc plutôt sympathiques et ouverts d’esprit, faisant rarement état de leur supériorité supposée. Pourtant, le vernis craque à l’occasion d’une scène aussi romanesque que d’une violence symbolique rare. Dissimulés sous une table, trois des membres de la famille entendent leurs patrons, toujours si polis et aimables, se moquer de leur odeur. Ils comprennent alors que quels que soient leurs efforts, ils seront toujours des moins que rien aux yeux des autres. Des pauvres à l’odeur caractéristique, même si elle est purement psychologique. Les masques achèvent de tomber lors d’une garden party où le maître de maison rappelle brutalement à son employé qu’il doit accepter de faire tout ce qu’on lui demande, puisqu’il est payé pour ça. Que tout s’achète, même la dignité ou le libre-arbitre. Et que la vie d’un enfant riche vaudra toujours plus que celle d’un enfant pauvre.
Fidèle à son habitude, le réalisateur incorpore ainsi un discours social fort aux ingrédients habituels du film de genre. Dans Parasite, la violence est multiple, décuplée par la misère et le mépris de classe, explosant dans quelques scènes spectaculaires et frontales, sanglantes et cruelles, filmées par une caméra aérienne et implacable. De la même manière, l’humour (noir) surgit aux moments les plus dramatiques, apportant un contrepoint ironique à l’extrême violence du récit comme aux différents rebondissements de l’intrigue. Il oblige le spectateur à porter un regard moins premier degré sur ce qui lui est montré, et à démêler ce qui relève du divertissement et ce qui se rapporte à la dénonciation sans fard d’un système qui court à sa perte. On peut, à l’issue du film, s’interroger sur les véritables parasites du titre. Qui sont-ils, et comment sont-ils arrivés là ?
C’est dans cette optique qu’il faut envisager l’épilogue plus cynique qu’utopique du récit. Car si les classes les plus modestes tiennent les classes plus aisées comme responsables de leur misère, elles ne souhaitent rien d’autres que les rejoindre, voire les remplacer. Et continuer mécaniquement à entretenir le système.
MpM

 

  
|
 |
|