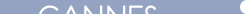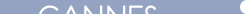|
Choix du public : 
Nombre de votes : 26
 

 

 

 

 

 

|

|
 |
 |

L'homme qui tua Don Quichotte (The Man Who Killed Don Quixote)

Sélection officielle - Fermeture
France / sortie le 19.05.2018


BACK IN LA MANCHA
« Ah, c’est un bouquin ? On a les droits ? »
Le moment le plus drôle du film se situe tout au début, lorsqu’un carton précise en préambule : « Après 25 ans de besogne et de foire d’empoigne » avant d’afficher le titre du nouveau et tant attendu long métrage de Terry Gilliam : L’homme qui tua Don Quichotte. Comme une manière de signifier d’emblée que le cinéaste a choisi la piste de l’autodérision, utilisant le lourd passé autour du projet avorté (voir Lost in la mancha et les nombreuses mésaventures autour du premier Don Quichotte auquel Terry Gilliam avait dû renoncer) comme matière même du projet final.
Nous voilà donc immédiatement face à plusieurs récits imbriqués : celui qui montre Don Quichotte de Cervantes aux prises avec des moulins à vent (l’un des épisodes les plus célèbres du roman). Celui du tournage, par un réalisateur fou et talentueux nommé Toby, de cette séquence de Cervantes destinée à servir de spot publicitaire. Celui du premier film de Toby, qui était déjà une adaptation du roman. Et ainsi de suite, si bien que l’on comprend presqu’immédiatement que ce récit complexe aura plusieurs dimensions, mêlant réalité, fiction et fantasme avec une telle virtuosité qu’il n’est plus possible de les distinguer.
Au départ, on est clairement dans une satire de l’industrie du cinéma avec son producteur inculte et imbu de lui-même, obsédé par le profit, et son réalisateur de génie, mais parfaitement insupportable. Le ton est à l’humour noir et à la moquerie, avec des dialogues finement écrits qui apportent une forme de frénésie à cette première partie. Puis, peu à peu, la farce un peu grotesque reprend le dessus, avec une histoire d’adultère tarte à la crème, puis le périple absurde et décousu de Toby à la recherche de ses acteurs d’autrefois, qui le confrontent au passage aux réalités contemporaines du monde, et notamment à des campements de réfugiés. Dès lors, le film multiplie les outrances et les situations comiques que l’on croirait tout droit sorties de cartoons, que ce soit les chutes à répétition de Toby ou les scènes d’action de pacotille, comme l’attaque de la voiture de police par Don Quichotte, ou la séquence totalement chaotique qui suit.
L’intrigue bascule alors dans une forme de fuite en avant outrée et foisonnante, folle et en roue libre, qui joue sans cesse sur les correspondances entre les personnages et les époques. Ainsi, l’ancien interprète de Don Quichotte est resté coincé dans son rôle et s’imagine être le véritable Don Quichotte. Il croit alors retrouver Sancho (en réalité Toby), et se lancer dans des aventures toujours inspirées par l’œuvre originale de Cervantes. En parallèle, Toby se remémore le tournage de son premier film et les circonstances qui l’ont conduit à choisir ses comédiens. Comédiens sur lesquels les personnages ont fini par déteindre profondément. Et comme si cela n’était pas assez confus comme cela, se greffent également à l’histoire un mafieux caricatural, une jeune femme résignée, et une manipulatrice qui apportent de nouvelles couches narratives à une intrigue qui n’avait pas forcément besoin de tout cela.
Avouons-le, cette richesse narrative et visuelle noie le spectateur à force de rebondissements et de gags. On est en effet comme abreuvé de mouvements et de monumentalisme, de séquences spectaculaires et de rebondissements qui se succèdent sans fin. Toutefois, en dehors de cette forme d’hystérie scénaristique, Gilliam a particulièrement soigné la direction artistique du film, avec des couleurs vives et des décors monumentaux. Au détour du chemin, on croise des géants et des monstres, un dragon, des trolls et quantité d’autres créatures dont on ne sait jamais si elles sont réelles (par exemple lors de la fête costumée), ou juste le fruit de l’imagination des personnages, tous contaminés par Don Quichotte. Tous les personnages avancent ainsi masqués, entre faux semblants, passages oniriques et surtout une grosse dose de n’importe quoi joyeux et foutraque.
Evidemment on attendait de Terry Gilliam qu’il triture Cervantes jusqu’à l’intégrer entièrement à son univers et ses choix de cinéma. La frontière floue et confuse entre le monde de la fiction et celui de la réalité, entre Cervantes et Gilliam, entre la folie et la satire, suggère alors d’intéressants territoires à explorer. Pourtant, on ne peut s’empêcher d’être déçu par le résultat final, que l’on aurait paradoxalement souhaité plus délirant et iconoclaste.
Car bien que réellement sous acide et jouant la carte de l’outrance systématique, le film souffre de ces ruptures de ton permanentes qui empêchent le récit de s’installer dans la durée. Finalement, l’œuvre la plus attendue du XXIe siècle est une pochade excentrique mais inégale, qui ne sait pas toujours quoi faire de sa propre ambition, ni de l’imposante référence littéraire qu’elle convoque. Au bout d’une heure de film, on se désintéresse de cette succession presque mécanique de saynètes qui n’abordent que superficiellement leur sujet et retombent dans des questionnements assez peu métaphysiques : l’amour peut-il être salvateur, une rédemption est-elle possible, et doit-on poursuivre éternellement ses rêves aussi chimériques soient-ils ? A cette dernière interrogation, le film répond lui-même par la négative. Parfois, il faut savoir reconnaître que certains espoirs sont faits pour être déçus.
MpM

 

  
|
 |
|