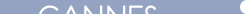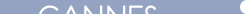|
Choix du public : 
Nombre de votes : 16
 

 

 

 

 

 

|

|
 |
 |

Les fantômes d'Ismaël

Sélection officielle - Ouverture
France / projeté le 17.05.2017 / sortie le 17.05.2017


LA VIE DES AUTRES
« J’ai 21 ans de désespoir derrière moi »
Si l’on doutait encore qu’Arnaud Desplechin soit l’un des plus grands cinéastes français de notre époque, il nous prouve coup sur coup (avec Trois souvenirs de ma jeunesse en 2015 et Les fantômes d’Ismaël aujourd’hui) que son talent n’a pas plus de limite que son imagination et son audace. Rarement on aura vu un film d’ouverture cannois offrir une telle palette de sens, d’émotions et d’interprétations en faisant l’équilibre parfait entre le romanesque le plus captivant et le cinéma d’auteur le plus brillant. C’est vrai, on a facilement tendance à utiliser un terme comme « foisonnement » dans nos critiques, mais il trouve ici son acception pleine et entière, tant Les fantômes d’Ismaël donne le sentiment de raconter toutes les histoires à la fois, et de le faire avec un mélange de culot et de naïveté qui lui permet d’être réussi du début à la fin.
Passons immédiatement sur l’unique défaut que l’on trouve au film : le jeu théâtral et forcé de ses comédiens. Les dialogues, très écrits et souvent très savoureux, y perdent en spontanéité. C’est évidemment un parti pris de la part du réalisateur, qui insuffle de cette manière une distanciation permanente entre le spectateur et les personnages. Comme une manière de lui rappeler qu’on est dans la fiction où l’invraisemblable est le lot commun. Et il faut reconnaître que le scénario est haut en couleurs, ménageant suspense et rebondissements, et même quelques incursions dans le film de genre. L’imagination, le rêve et la fiction contaminent le réel à plusieurs reprises. Même la musique vient souligner les moments dramatiques pour prouver que le film ne se prend pas au sérieux. Ces éléments ajoutent un second degré, un double niveau de lecture, qui viennent sans cesse rappeler qu’il y a derrière les aléas de l’histoire un auteur tout-puissant qui s’amuse à démontrer le pouvoir du cinéma.
Arnaud Desplechin surprend d’ailleurs par la forme déroutante de ce film qui passe d’une intrigue à l’autre, mêle fiction et réalité, raconte en parallèle la fin d’une histoire d’amour et le début d’une autre. Par la magie du montage, les temporalités se mêlent, des scènes éloignées dans le temps se répondent, on passe d’une intrigue à une autre, de la réalité à la fiction, du passé au présent. Mais il ne faudrait surtout pas croire que tout cela est décousu ou brouillon. Au contraire, le film est d’une maîtrise et d’une densité étonnantes, bien qu’il soit fait de bribes et d’éclats, et nous laisse parfois sur notre faim (nous n’avons pas encore eu la chance, nous, de découvrir la version longue et de connaître les éléments laissés hors champ par cette version resserrée autour du triangle amoureux).
Le cinéma est là pour se permettre toutes les libertés narratives. Desplechin s’affranchit donc de la norme et raconte toutes les histoires en même temps, ou en tout cas comme au même niveau d’importance. On embrasse tour à tour le point de vue de chacun des personnages. Tous existent par le biais d’une angoisse, d’une vulnérabilité, d’un enthousiasme. Chacun nous amène vers un autre, comme des poupées gigognes où toutes les poupées auraient la même taille et la même importance. Dans la réalité, les rôles secondaires et les figurants de notre existence sont les personnages principaux de leur propre histoire, et c’est comme si, à travers cette multitude de personnages, Desplechin captait exactement cet effet-là.
Il entremêle ainsi le cinéma et la vie sans qu’il soit nécessaire de les démêler. D’ailleurs, peut-être est-ce simplement la même chose, juste vue d’un autre point de vue ? C’est un peu ce que semblent dire les références artistiques qui émaillent le film : l’opposition entre la peinture flamande et la peinture italienne pour cause d’un choix de perspectives radicalement différentes, la peinture « figurative » de Jackson Pollock où plusieurs histoires sont compressées en un seul tableau… La vie d’Ivan, racontée par Ismaël, est ainsi à la fois une fiction pure (pour le spectateur), une biographie romancée (pour Ismaël), et une réalité (pour celui qui l’a vécue).
C’est peut-être là l’aspect le plus abstrait du film, mais pas le moins intéressant. Cette manière de théoriser discrètement sur ce qu’il fait (ah, la séquence où le cinéaste raconte à son producteur médusé la suite du film qu’il a laissé en plan), d’approfondir le sillon, toujours en recherche d’un sens cinématographique, artistique à chacun de ses choix. Par exemple, à chaque fois qu’il place ses personnages au bord du drame, il gère la situation comme un cas d’école, à bonne distance, en pleine empathie pour chacun, sans contourner le problème, mais sans en faire des tonnes. Ce qui ne l’empêche pas de s’autoriser une fantaisie extrême (l’enlèvement rocambolesque du cinéaste, le face à face décalé entre les deux amoureuses rivales), une énergie communicative, et une audace permanente. Il faudrait citer tous les acteurs, qui rayonnent d’avoir tant à jouer. Matthieu Amalric, évidemment, admirable en homme à la fois éperdu et flamboyant, hanté et imprévisible, démiurge qui ne contrôle plus rien. A ses côtés, Charlotte Gainsbourg est lumineuse et d’une grande finesse, roc solide dans une tempête de sentiments.
A travers ces êtres complexes, ces fragments de vie et cette réflexion latente, c’est un portrait de l’artiste en creux qui apparaît. Une sorte d’autoportrait flou qui convoque tous les fantômes qui hantent le créateur au moment de la création. Toutes les voies possibles qui s’offrent à lui, aussi. Raconter une histoire d’espionnage, observer la fin d’une passion, parler d’une fille et de son père, s’enflammer pour une nouvelle histoire d’amour… Et pourquoi choisir ? Desplechin s’y refuse, et nous offre un film vif et enlevé, toujours dans le mouvement, dans la surprise, construit sur les ruptures de ton et adoptant un rythme syncopé qui repousse les frontières du romanesque. On en reste ahuri, émerveillé que le cinéma puisse être tout cela à la fois, et donner encore l’impression qu’il y aura plus à comprendre à la deuxième vision, et à toutes les suivantes.
MpM

 

  
|
 |
|