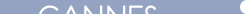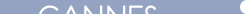|
Choix du public : 
Nombre de votes : 24
 

 

 

 

 

 

|

|
 |
 |

Synecdoche, new York

Sélection officielle - Compétition
USA


A LA RECHERCHE DU PASSE PERDU
« Je sais ce qu’est un neurologue. J’ai cru entendre urologue.»
Commencer son premier film par un texte de Rilke au réveil lu à la radio, c’est rude, déprimant, mélancolique, beau, hilarant. Du coup, Charlie Kaufman a fait naître un grand espoir sur son film, et, durant une heure, nous fera croire à une œuvre surprenante, inattendue, rare. Mais, à l’instar de son personnage principal, un metteur en scène de théâtre qui essaie d’inventer l’œuvre dramatique la plus proche de la vérité, il se perd dans son propre scénario, en éternisant sa fin, alors qu’aucune idée majeure ne survient. Pris de vertige par son sujet -des acteurs jouent la vie des acteurs de la troupe de cette pièce constamment réinventée jusqu’à reproduire le réel dans un hangar gigantesque – Kaufman ne parvient plus à insuffler l’ironie et l’humour de la première partie du film. Cette rupture de ton nuit fortement au plaisir éprouvé et nous fait décrocher au point de devenir indifférent à ce personnage pourtant touchant, en quête d’un bonheur perdu.
Mais reconnaissons que Kaufman a du génie pour l’écriture. Une originalité qui tranche clairement avec le formatage actuel. Film éminemment morbide, hanté par les remords, les regrets, les actes refoulés, Synecdoche New York cherche à transgresse plusieurs tabous : une mère qui rêve de voir mourir son enfant pour être de nouveau libre, des plans sur des toilettes après les différentes commissions, la mort qui touche un à un la plupart des protagonistes, le sexe comme expiation d’une souffrance, le corps humain et tous ses maux... La première heure est filmée avec de nombreux gros plans, des détails de la vie quotidienne, tandis que la seconde prend une ampleur plus démesurée. Nous passons alors d’un cinéma quasiment social, un portrait d’un américain dépressif, à un film plus expérimental et philosophique, où l’on croise parfois l’ambiance de la trilogie « scénique » de Lars Von Trier.
Comme si Kaufman voulait absolument raconter deux histoires, faire coexister ses deux « délires ». Le côté « Je peux pisser dans l’évier ? » avec l’aspect plus sombre sur le sens de la vie. La défonce et le sérieux. Mais le pont entre les deux n’existe pas nous laissant regarder l’heure finale d’un point de vue très extérieur, à la limite de l’ennui. Comme un blues après la surexcitation. Un grain de folie qui conduit le film à manipuler le temps et le rendre absurde, s’étirant sur des décennies, ponctué par des ellipses subtiles, abordant trop superficiellement des sujets d’arrière plans. Nous voilà donc un peu paumé dans ce faux monde, reconstitué et sombre, nous ramenant parfois à des scènes passées, déjà vues. Répétition qui accentue l’ennui.
Il reste un portrait d’un créateur tourmenté, la difficulté de vouloir se distinguer, et surtout les femmes, toutes formidables. Ses muses sont tout autant castratrices qu’inspiratrices. L’homme se laisse broyer par elle, obéissant à leurs ordres, cherchant à pleurer sur leur sein. Un faible à l’existence solitaire et merdique qui s’avoue lâche face à la mort.
Prince du bizarre, Kaufman n’a pas failli à sa réputation. Mais l’œuvre impitoyable et sans concession qu’il rêve d’écrire ne sera pas encore celle là, trop soumise à ses divagations, sous l’emprise, comme Desplechin, de son intelligence.
En voulant prouver que l’art peut révéler l’inconscient mais ne peut pas reproduire le réel, Synecdoche New York assume son ambition sans trouver les solutions qui le rendraient sensationnel.
vincy

 

  
|
 |
|