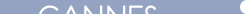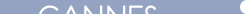|
Choix du public : 
Nombre de votes : 59
 

 

 

 

 

 

|

|
 |
 |

Che

Sélection officielle - Compétition
USA


EL FIDEL
"Le véritable révolutionnaire est guidé par l’amour"
En se focalisant uniquement sur deux épisodes-clef de la vie d’Ernersto Guevara (sa formidable ascension lors de la guérilla cubaine et son irrésistible chute lors de la tentative de révolution en Bolivie), Steven Soderbergh évite l’écueil du biopic traditionnel exhaustif et pédagogique tout en donnant une vision riche et complexe de la personnalité de son héros. Chaque épisode fait l’objet d’un film à part entière et bénéficie d’un style et d’une tonalité spécifique lui permettant d’aller au plus près de son propos. D’abord lumineux et joyeux, puis sombre et tragique. Soit deux éclairages distincts pour un même homme.
Part 1 : l’espoir
Le premier volet est celui des références et de la virtuosité. Pendant plus de deux heures, c’est un foisonnement de temporalités, de lieux et de situations qui rappelle la construction éclatée de Traffic. Touche par touche, détail après détail, Soderbergh construit "son" Che. Un peu à l’image de Todd Haynes et Bob Dylan (I’m not there), il offre un aperçu kaléidoscopique des nombreux visages de son héros. Le médecin, le guérillero, le révolutionnaire, l’humaniste, le pédagogue, le politicien… les personnalités d’Ernesto Guévara se mêlent et se complètent dans un montage virtuose qui juxtapose l’ONU et la jungle dans un même élan sans jamais sonner faux. En voix-off, le Che décortique ses idéaux, raconte ses exploits, se souvient de ses faits d’arme. A l’image, il est sur tous les fronts, réglant les différends, corrigeant les devoirs de math de ses hommes, sélectionnant les nouvelles recrues, rendant la justice… mais toujours au service de la collectivité.
La notion de groupe et de sentiment d’appartenance s’avère en effet primordiale pour comprendre la personnalité du révolutionnaire. Soderbergh le filme ainsi systématiquement au milieu de ses hommes, rouage certes essentiel, mais non unique, d’un mouvement qui ne peut se réduire à sa propre personne. D’où l’importance donnée aux scènes de retrouvailles et d’embrassades qui reviennent comme un leitmotiv tout au long du film. Cela va bien au-delà de la popularité ou même de la starisation, comme si le Che dépassait sa nature d’individu unique pour s’incarner dans chacun de ses camarades. Avant même d’avoir triomphé, il porte déjà tous les attributs qui feront de lui une icône (le béret, le cigare, la barbe) et contribuent à l’édifier en mythe vivant.
La dernière partie du film, celle qui comporte le plus de scènes d’action, nous emmène sur un autre terrain, tout aussi référencé. Les combats évoquent le western, la stratégie adoptée pour investir l’Eglise (casser à coups de masse les murs fondateurs de cinq maisons) est un clin d’œil à la série des Ocean’s et même le mot de conclusion ("incroyable") semble plus s’adresser au spectateur qu’aux protagonistes du film. On est dans une vraie légèreté, ponctuée de pointes d’humour et même d’incursions dans le film de genre, avec impacts de balles et explosions à gogo. Le Che n’est plus dans l’insouciance de la jeunesse (captée avec justesse dans le très complémentaire Carnets de voyage de Walter Salles), mais à l’époque de tous les possibles. Un espoir démesuré commence à poindre en lui, qui sera à la fois l’instrument de son triomphe et sa chute.
Part 2 : la déchéance
Voir les deux volets à la suite a quelque chose de perturbant, tant cette seconde partie diffère formellement et scénaristiquement de la première. On est en 1966, le Che arrive clandestinement en Bolivie, et des intertitres fréquents comptent les jours. Une construction linéaire qui transforme d’emblée cet épisode final en tragédie irréversible. Plus l’on progresse dans le temps, plus l’univers se resserre autour du leader révolutionnaire qui voit ses hommes mourir les uns après les autres. De plus en plus isolée, il se lance dans une fuite en avant désespérée aux airs de chemin de croix. C’est à ce moment que la dimension christique du personnage prend toute son ampleur. Après avoir été salué comme le Messie, il devient une menace pour les autorités qui cherchent à avoir sa peau. Il passe alors par toutes les étapes d’une "Passion" d’un nouveau genre : souffrance, doute, trahison de ceux qu’il avait aidés, emprisonnement, exécution et enfin résurrection symbolique dans les dernières images. A croire que les messages d’amour et de paix récoltent systématiquement chaos et violence.
Passant de l’espoir au pessimisme le plus noir, Steven Soderbergh décortique l’échec de la révolution bolivienne avec une intransigeance courageuse. Il capte la lente déchéance qui s’empare du héros (sale, diminué physiquement, impuissant à sauver ses hommes, en un mot pathétique) et le montre dans de longs plans éprouvants privé de souffle au sens propre comme au figuré. Oubliée, salie, brisée l’image de héros surhumain construite dans le premier volet. Ici, chaque scène, chaque difficulté, chaque tentative semble le pendant dégradé d’une situation connue lors de la révolution cubaine. Ce qui avait triomphé la première fois échoue lamentablement la seconde sous le regard incrédule d’Ernesto Guévara. Et plus les choses lui échappent, plus il s’entête, persuadé qu’il parviendra à réitérer l’exploit cubain. Comme tous ceux dont le coup d’essai fut un coup de maître, le guérillero n’a de cesse que de connaître à nouveau une telle sensation, quitte à mourir en essayant. Pour un réalisateur comme Soderbergh, qui a reçu la palme d’or à 26 ans pour son premier long métrage, le sujet n’a rien d’anodin ni d’innocent. On sent le regard très personnel qu’il porte sur les erreurs du Che (incapable de voir que le contexte bolivien est très différent de celui de Cuba, et notamment qu’il ne bénéficie ni du soutien de la base, ni de celui du parti) et sur son aveuglement idéologique (il s’imagine qu’il lui suffit de défendre une cause juste pour triompher).
Esthétiquement, le film tranche également avec le premier. Comme pour ne pas être redondante avec le propos, l’image reste lumineuse et colorée (Soderbergh utilise des filtres pour donner à certaines séquences des tons verts, jaunes ou bleutés), souvent très composée, notamment dans les séquences de jungle qui prennent des aspects presque surréalistes. Comme si la nature reprenait ses droits, non pas de manière violente, mais en offrant un écrin confortable et chaleureux à la douleur humaine. Les trouées de lumière qui éclairent le pauvre corps meurtri du Che lors de l’assaut final semblent ainsi un signe des cieux reconnaissant à sa juste valeur le martyr et le sacrifice du révolutionnaire. Dans sa globalité, la mise en scène accompagne et met en valeur l’intrigue plus qu’elle ne cherche à se substituer à elle, jouant de la pesanteur de certaines séquences, de la majesté des plans larges ou de la multiplication des gros plans pour instiller au film une dimension universelle et moderne. Car si l’histoire du Che fascine autant, ce n’est pas tant parce qu’il est devenu l’icône d’une génération avide de rébellion que pour sa profonde humanité.
MpM

 

  
|
 |
|