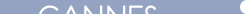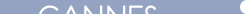|
Choix du public : 
Nombre de votes : 76
 

 

 

 

 

 

|

|
 |
 |

Le scaphandre et le papillon

Sélection officielle - Compétition
France


UN ESPRIT INVAINCU
« - Ça, c’est la vie ? »
Nous voici immédiatement, dès le premier plan, dans l’œil du personnage. La caméra est subjective. Le noir d’un clin d’œil obstrue parfois la lumière. Les images peuvent être floues, distordues, saturées de lumière. L’immersion nous oppresse. La voix off d’Amalric nous fait comprendre que nous sommes dans sa tête. Julian Schnabel frappe très fort, sûrement trop, dès les premiers instants, nous faisant croire à une promesse qui sera, partiellement non tenue. Au fil du film, l’élan s’estompe, empêchant l’émotion de nous bouleverser complètement. Contrairement à Mar Adentro où Amenabar nous secouait avec un crescendo ultrasensible, Le scaphandre et le papillon plonge dans une certaine déserrance où les personnages muent en virtuelles incarnations fantomatiques. Le scénario se délie et n’amène plus de nouveaux protagonistes ou de nouveaux faits pour nourrir une histoire qui ne manque pas d’intérêt. Dès la fin du prologue, c'est-à-dire quand l’œil droit est recousu, quand la caméra vient observer pudiquement l’homme piégé dans son corps, le script s’anime de différents éléments : flash back vers une vie d’excès, de fashion victim, comme dans tous les films de Schnabel ; pensées intérieures, entre sarcasmes lucides, dérision cynique, désespoir fataliste ; les femmes, dont les visages dessinent rapidement le contour d’un portrait idéal du féminin – Croze déterminée et lumineuse, Seigner jalouse et fidèle, De Caunes suave et irréelle, Hands fraîche et attirante, Garmendia, sensuelle et patiente. Evidemment Anne Consigny, son double, son miroir, sage et libre.
Le film, baignant pourtant dans le drame, ne manque pas d’humour (superbe jeu de langue pour apprendre à avaler), et de foi. Faut-il approcher de la fin pour que Dieu soit si présent : le film s’imprègne d’une croyance presque factice, baroque, pour nous faire croire à une autre fin que ce décès inéluctable. La science ne semble être qu’un outil illusoire pour lui permettre d’écrire son livre avant le Grand départ. Car il lui reste l’imagination, la mémoire et un œil. Les trois forment les piliers fondateurs du film. L’imagination donne lieu à des moments oniriques, où Schnabel insuffle toute son inspiration. La mémoire créé les flash backs. L’œil permet d’observer les visages, les décors. L’intensité n’est jamais aussi forte que dans le présent et le réel. C’est lorsqu’il est otage qu’il nous saisit. C’est l’appel du père quand il est paralysé, plus que son dialogue avec lui lorsqu’il est fringant, qui nous touche et tire les larmes. Bien sûr il fallait illustrer le côté papillon, et pas seulement s’appesantir dans ce scaphandre. Mais Schnabel sait transmettre le chagrin, davantage que le bonheur passé.
Ode à la vie, à travers ses paysages nordistes et ces femmes soignantes, il est aussi un hymne au romanesque, maladroit mais bien intentionné. Amalric porte brillamment le rôle sur ses épaules. Il manque une étincelle, un grain de folie, un regard moins respectueux, plus distancié, pour que le film nous emporte autant qu’on ne le souhaiterait. Sa générosité, sa chaleur, sa bienveillance en feront assurément un coup de coeur du public...
Cependant l’œuvre est trop admirative vis-à-vis courage d’un individu, qui a voyagé de son premier mot (« Je ») à un roman (best-seller). Hélas, Le scaphandre et le papillon, se fatigue comme son personnage, et ne l’humanise pas assez. Nous constatons alors que chacune des relations est trop anecdotique pour nous rendre ce scénario mémorable. Il ne reste que les tours de force qui ont fait avancer un paralytique sur les chemins de la gloire... En premier lieu, son histoire, ses interprètes et un réalisateur qui a trouvé le bon matériau pour toucher les spectateurs au coeur.
EN

 

  
|
 |
|