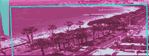|  |
 |
 |
 | Production: JoAnne Sellar / Ghoulardi Film Co
Réalisation: Paul Thomas Anderson
Scénario: Paul Thomas Anderson
Montage: Leslie Jones
Photo: Robert Elswit
Musique: Jon Brion
Durée: 1h31 |
|
 |
 | Adam Sandler: Barry Egan
Emily Watson: Lena Leonard
Philip Seymour Hoffman: Dean Trumbell
Luis Guzman: Lance
Mary Lynn Rajskub: Elisabeth
|
|
 |
|
 |
|
|
 | |
Punch-drunk love
USA / 2002 /
Compétition/ Présenté le : 19.05.02 |  |
Tout tourne trop vite autour de Barry Egan. Entre son job mortel et ses sept frangines qui l'obligent à se trainer des casseroles depuis tout petit, il n'est jamais parvenu à se rendre vraiment maître de son destin. Loin de se décourager, il se persuade qu'une promo de paquet de pudding pourrait lui servir de sésame.
d'autant que ce jour là, il croise une jolie blonde, appelle une blonde très chaude, et finalement part à la conquête de l'une et se fait arnaquer par la seconde.
|  |
C'est la première fois que le jeune prodige Paul Thomas Anderson se retrouve consacré à Cannes, 3 ans après son Ours d'or à Berlin.
Sydney lui avait valu une sélection dans Un Certain Regard en 96. Le voici en Compétition Officielle du Festival de Cannes, après deux films brillants, exaltants et louanges : Boogie Nights et Magnolia. Ses films avaient pour particularité d'être dotés de castings impressionnantes, d'avoir un scénario complexe, et traitant de sujets souvent tabous. Les deux scripts ont d'ailleurs été nominés aux Oscars. Ici, rien de tout cela.
L'idée lui est venue simplement. Un article paru en 2000 dans Time racontait l'histoire de David Phillips, ungénieur, qui gagna 2 millions de kilomètres en avion en ayant acheté 12 150 pots de pudding Healthy Choice. Il est devenu "Pudding Guy".
"Après Magnolia, qui était un film sombre, lourd et difficile à faire, je souhaitais m'engager dans quelque chose de plus tendre, de plus émouvant explique le cinéaste (32 ans) (en couple avec la chanteuse Fiona Apple dont il réalise les clips). Avec une musique années 50, l'abus du technicolor et deux comédiens en contre-emploi, le tout dans une courte durée (90 minutes), il relève son défi : faire tourner le comique Adam Sandler. Pour une fois celui-ci ne sera pas un idiot, ou un niais. Son humour l'a rendu très populaire aux USA, mais les films le mettant en vedette ont été des flops en Europe. On le retrouvera ironiquement dans le prochain Nicholson, lui même en Compétition cette année. Il sera surtout dans un rôle dramatique, impulsif, décalé. Emily Watson aussi sera un personnage jamais vu : ni malade, ni mourrante, ni surdouée; juste une fille banale et fraîche. Elle fut révélée à Cannes, avec Breaking the Waves en 96. Ce film lui permit d'obtenir plusieurs prix. Elle est aussi la vedette de Gosford Park. Philip Seymour Hoffman est un personnage habitué de l'univers d'Anderson, ayant joué dans tous ses films.
Il faut noter que les oeuvres d'art qui s'incrustent dans le film sont de Jeremy Blake, spécialiste en projections artistiques numériques.
|
 |
|
 |
 |
 |
| COUPON GAGNANT "- Il y a un piano dans la rue."
Il est silencieux, spécial, et seul. Pas comme les autres c'est à dire nerd, gay ou pervers. Tout ce qui semble différent est détesté, incompris, rejetté. Il a beau être barge, complexé, attachant, peu bavard, personne ne veut s'interesser à lui. Parce que Barry Egan ne supporte pas le quotidien, la normalité des gens, le bordel d'une société incohérente et injuste, il choisit de s'exprimer par une forme de mutisme, de pointillisme et parfois par quelques excès de furie non contrôlés.
Mais cela ne suffirait pas. Un film n'existe pas à travers un personnage, aussi original soit-il. Isolé et introverti, Barry vit dans un enironnement vide et éthéré, une Los Angeles à la fois contemporainement banale et aux allures post-moderne. L'atmosphère qui l'encadre est dingue et réelle, étrange et singulière, déserte et bruyante, absurde et banale.
On comprend alors que tout le film repose sur l'excellent Adam Sandler. Lui vit dans son rythme, avec sa perception de la réalité, pendant que la frénésie s'empare des autres, que la vie les détruit par un temps irrémédiable.
Paul Thomas Anderson a écrit des dialogues qui font sourire, à l'ironie mordante; les scènes percutent par leur surréalisme et l'image se lit à plusieurs niveaux : du simple esthétisme au sens le plus analytique. Car il dégomme et décrypte la société de consommation, le matérialisme ambiant, le rêve à bas prix et le confort à crédit. Il n'oublie pas le domaine du sentimental ni le secteur sexuel. Il décrit une vie où nous pouvons voyager gratos en se gavant de pudding. Tout, même le plaisir, s'achète. Sauf peut être l'amour.
Les temps sont durs pour les solitaires, associables et rêveurs. Le personnage de Sandler va à reculons ou alors il se perd, dès qu'une femme pénètre trop son intimité. En croisant une jeune femme adorable - la jolie Emily Watson - le film dévie vers une histoire plus convenue, entre éden et enfer, sur le mode d'After Hours.
Malgré tout les événements comiques qui surviennent, ce fou en costard de stewart nous entraîne dans sa mélancolie dépressive et sa quête d'absolu. Grâce à une série de suprises et d'accidents, tout va à 100 miles à l'heure. Comme si les gens qui l'entourent étaient irresponsables face à des hasards tyranniques. La vie semble compressée pour tenir en 90 minutes - et là est la principale réussite du film, en montrant à quel point tout file vite, tout s'oublie rapidement. Quand profite-t-on de la vie?
A l'instar d'un Tati - référence obligée de l'année - le jeune surdoué Anderson parvient à nous faire rire sur une trame sensible, avec un tableau de la société angoissant. Car pour le jeune cinéaste, jusqu'ici tout allait bien. Paul Thomas Anderson - scorsesien jusqu'au bout du travelling - nous avait envoûté avec des histoires à tiroir, des destinées passionnelles, une atmosphère d'opéra aussi vaste, riche et variée que la ville-décor de Los Angeles. En changeant de registre, et par conséquent en prenant un risque, il pouvait nous décevoir. Certes son film n'a pas l'impact des précédents, mais il gagne en charme et en légèreté. Punch Drunk Love, entre délire scénaristique et film personnel romantique fout une sérieuse pêche malgré la gueule de bois qu'il impose.
Car dans cette atmosphère hystérique de supermarchés abondants, de hangars dépeuplés, et d'hôtels impersonnels, son personnage a suspendu son élan. Etouffé par ses 7 soeurs, pourchassé par une pûte et son mac, ce mec trop gentil en ces temps cyniques devient le symbole de la perversion qu'il faut abattre. Il leur renvoie l'image de ce qu'ils sont : des êtres sans âme. Comme il ne s'instéresse pas aux autres et qu'il ne s'aime pas, les autres lui renvoient l'ascenceur. Il ne put que fuir, courir, poursuivre son idéal. Sa maladresse touchante, au détour d'un couloir ou d'une impasse, d'un escalier ou d'un trottoir, se transforme en amour dévorant. Sa parano hitchcockienne se méla,nge à la névrose des Neil LaBute. Les ombres chinoises se mixent aux kaléïdoscopes colorés. L'harmonium délaissé se joint au coupons réponses découpés. Paul Thomas Anderson nous tient en haleine tout au long de cette folle odyéssée d'un gars maîtrisant parfaitement les clauses du contrat avec la société, mais totalement démuni face à ses congénères.
Du coup, la fin nous laisse un peu essoufflé. Trop discrète, trop facile, trop simple. Un Happy-end serein et distant. Le cinéaste est déjanté, et conclut avec moralité, son écriture est juste mais elle manque de subversion. Il nous laisse insatisfait mais heureux. Avec un vrai talent de mise en scène, on regrette que la partition ne soit pas aboutie à cause des cinq dernières minutes. Ca rime malgré tout avec le mot "culte".
|
|
 |
|  |